

Il n’y aura pas vraiment d’après. Rien ne sera profondément bouleversé, rien ne sera fondamentalement différent, les changements seront ténus. Je ne doute pas, par exemple, que l’abstention sera moins abyssale que prévu aux élections départementales du mois de mars, mais cela ne changera pas grand chose au résultat et si l’élection de conseillers départementaux modifiaient vraiment le cours du monde, cela se saurait. Les gens seront déçus, forcément. Une déception qui finira bientôt par transparaître dans les discours, que ce soit dans les médias ou au café du commerce. Les hommes politiques n’ont pas été à la hauteur, la société française n’a pas été à la hauteur, les autres n’ont pas été à la hauteur, mais personne pour dire qu’il n’a pas été lui-même à la hauteur évidemment.
Il n’est pas question pour moi de me lancer dans la rédaction d’un texte cynique. J’espère que ceux qui me lisent de temps à autre savent bien que ce n’est certainement pas mon genre. Simplement, les déséquilibres géopolitiques et les fractures spécifiques à la société française ne vont pas se résorber du jour au lendemain, surtout que si quelqu’un avait la moindre idée de comment y arriver en ne serait-ce qu’une décennie, j’ose espérer qu’il l’aurait clamé haut et fort.
Pas de cynisme, mais peut-être quand même un peu de découragement face à ce monde qui m’inquiète de plus en plus. Comment on est-on arrivé là ? Et pas simplement à cet attentat ignoble, mais à l’état plus général de notre planète. Le premier événement marquant auquel ma génération a assisté est la chute du Mur de Berlin. La fin de l’histoire pour certains… A l’époque au moins, la fin d’un monde coupé en deux. Ensuite, je me rappelle avoir pleuré devant ma télévision, en assistant en direct à la poignée de main entre Yasser Arafat et Yitzakh Rabin. Cette décennie a vu le monde prendre, à Rio, les mesures efficaces pour sauver la couche d’ozone, grâce à une coordination à l’échelle mondiale. A cette époque, toute la France regardait en prime time les Inconnus parodier la vie de Jésus et toute la France se marrait dans une bonne humeur partagée et bon enfant.
Puis Yitzhak Rabin est mort assassiné. Le 11 septembre a poussé certains à parler de choc des civilisations. Le protocole de Kyoto s’est enlisé. Jusqu’à Charlie…. Peu à peu, une espérance collective en des lendemains meilleurs a laissé place à une immense angoisse. Le monde paraît aujourd’hui terriblement anxiogène, même pour ceux qui semblent à l’abri du besoin. La tension semble au plus haut un peu partout. L’obscurantisme fleurit et couvre de son ombre une partie de plus importante de la société. Les liens entre les humains se délitent de manière inexorable. Et lorsqu’ils se resserrent, c’est généralement face à un ennemi à abattre.
Mais le tout n’est pas de constater tout cela, mais de se demander pourquoi. Et là, j’avoue faire face à une abîme de perplexité. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Evidemment, chaque événement pris isolément a son explication, son contexte, son histoire. Mais le tout semble porté par une vague sous-jacente prête à tout emporter, y compris ceux qui essayent tant bien que mal de ramer à contre sens. Mon impuissance à saisir les raisons profondes de tout ça et de là mon incapacité à agir me met en colère.
Peut-être qu’au fond que cette colère nouvelle est la meilleure nouvelle qui soit. Peut-être que nous avions peu à peu perdu notre capacité à nous indigner. A nous indigner vraiment. Les forces qui me font peur aujourd’hui ont sans doute toujours été présentes. C’est sans doute notre capacité à les repousser qui s’est étiolée. Pas forcément de beaucoup, mais suffisamment pour briser un équilibre fragile. Peut-être qu’au fond à force de lutter contre l’intolérance, nous sommes devenus tolérants à des choses qui hier nous révoltait.
Pourquoi ne sommes-nous pas descendus dans la rue après la tuerie perpétrée par Mohammed Merah ? Je ne crois pas qu’il y ait là la moindre forme d’antisémitisme. Tout simplement, la mort, aussi tragique soit-elle, d’inconnus n’arrivera pas à nous toucher autant que la mort de gens qui font partie de notre vie, de notre quotidien. Beaucoup de gens de mon âge ont souligné qu’ils ont connu Cabu en regardant le Récré A2. Avec lui est mort une partie de nous-mêmes, de nos souvenirs. Face à l’horreur anonyme, nous avons su au contraire développer un mécanisme de détachement pour ne pas être emporté par le flot d’horreurs qui se déversent sur nous dès que l’on regarde les infos. On ne peut pas vivre en étant bouleversé tous les jours par tous les drames du monde. Mais n’est-on pas collectivement devenus trop passifs et résignés ?
Au cours de ces derniers jours, j’ai été marqué par quelques détails qui m’inquiètent. Voir autant de monde rassemblé m’a forcément fait penser au 1er mai 2002, quelques jours du deuxième tour de l’élection présidentielle entre Jean-Marie Le Pen et Jacques Chirac. Les mêmes rues avaient été envahies par une foule peut-être pas aussi considérable, mais presque. Aujourd’hui, la présence ou non du Front National parmi les invités au rassemblement de dimanche fait débat, y compris au sein de ceux qui s’étaient alors levés contre lui, il y a moins de 13 ans. On peut refaire l’histoire, critiquer les uns ou les autres pour les mots exacts employés, mais rien que le fait qu’on en fasse un objet de discussion et de polémique, montre le chemin parcouru depuis. Et certainement pas dans le bon sens.
Comment a-t-on pu oublier Brahim Bouarram, mort noyé le 1er 1995 après avoir eu le malheur de croiser le cortège du Front National ? Si l’union nationale se fait contre quelque chose, alors elle ne vaut pas mieux que ce qu’elle combat. L’union nationale doit se faire atour de quelque chose, de valeurs à défendre au-delà de toutes nos autres différences. Comment en est-on arrivé à ce degré d’indifférence vis-à-vis du FN pour concevoir ne serait-ce qu’une seconde que l’on puisse se rassembler autour de quoique ce soit avec lui ? N’est-on pas en train d’adopter ce replis, cette solidarité d’assiégé qui guident justement ceux que l’on dit vouloir combattre ? Et surtout, pourquoi faut-il attendre désormais l’horreur absolue pour envahir la rue, quand avant un simple discours haineux parvenait à mobiliser à ce point ceux qui le refusait il y a encore peu de temps ?
Je ne veux pas déjà jouer à 35 ans, mais j’ai de plus en plus l’impression qu’une partie de la génération qui s’est construite dans ce monde de plus en plus inquiétant l’accepte comme il est. Qu’elle confond respect des différences avec la construction d’une société de plus en plus atomisée. Qu’elle ne hiérarchise plus les idées. Qu’elle fait la confusion entre l’esprit critique et la construction de raisonnements volontairement biaisés au service d’une idéologie. Peut-être est-ce là uniquement de la nostalgie mal placée et qu’à l’adolescence, une bonne partie de ma génération aurait ri devant Dieudonné. Nous avons eu la chance de rire à ce moment de notre vie devant Elie et Dieudonné, à une époque où être noir et juif pouvait être encore avant tout un prétexte pour en rire.
Le « vivre ensemble » a été au centre de beaucoup de discours. C’est vrai que peut-être tout part de ça au final. Que sans aller jusqu’à résoudre les grands problèmes géopolitiques ou sociaux, nous pouvons tous individuellement nous demander comment contribuer à une société où on aurait pas besoin d’institutionnaliser la fête des voisins pour à nouveau se parler. Mon père me racontait que quand il était petit, le soir dans le village près de Toulouse dont est originaire ma famille, on s’asseyait sur des bancs et on parlait. Et puis, un jour la télévision est arrivée et le soir chacun a fini par s’enfermer chez soi. J’ai parfois l’impression que nous revivons une pareille évolution à une autre échelle sans doute.
Je sais bien qu’il ne suffit pas de « se parler » pour résoudre tous les problèmes. Mais bordel de merde pourquoi y a-t-il aujourd’hui tant de problèmes qui, il y a encore si peu de temps, n’en était pas ? Vous l’aurez compris, je n’ai pas aujourd’hui de réponses à ces questions et je ne trouve personne qui m’en donne. Je me dis parfois que cela serait peut-être mieux d’oublier tout ça et de construire mon bonheur au sein de mon cercle de proches. Mais en tant que militant politique, j’ai évidemment envie d’autre chose, de contribuer à répondre à toutes ces questions, à toutes ces angoisses. Je ne sais pas si j’y consacrerai toute ma vie, mais au moins est-ce une quête qui vaut bien d’y consacrer son existence.

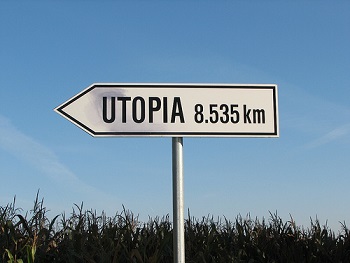






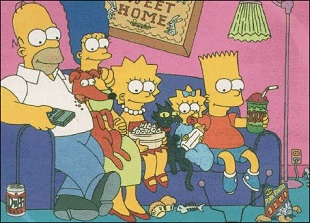
Commentaires récents