
 Au cours de ces dernières semaines, les appels au changement furent nombreux, en particulier dans la foulée des élections régionales. Evidemment, les changements en question concernaient rarement ceux qui les proféraient. Par contre, la fin d’année approchant, il est de tradition de prendre des résolutions pour soi-même. L’un et l’autre sont rarement suivis d’effet, mais étant un homme optimiste et plein d’espoir, j’ai décidé de mélanger un peu des deux en évitant si possible ce que j’abhorre le plus dans les discussions politiques, à savoir le don de leçons à bon compte. Alors, c’est pour cela que j’ai employé un « nous » tout ce qu’il y a de plus collectif et dans lequel je m’inclus volontiers. Il est évident que le changement ne doit pas concerner la seule classe politique, mais bien toute la société, des citoyens aux médias. Cependant, ce billet reste tout de même le discours d’un militant politique.
Au cours de ces dernières semaines, les appels au changement furent nombreux, en particulier dans la foulée des élections régionales. Evidemment, les changements en question concernaient rarement ceux qui les proféraient. Par contre, la fin d’année approchant, il est de tradition de prendre des résolutions pour soi-même. L’un et l’autre sont rarement suivis d’effet, mais étant un homme optimiste et plein d’espoir, j’ai décidé de mélanger un peu des deux en évitant si possible ce que j’abhorre le plus dans les discussions politiques, à savoir le don de leçons à bon compte. Alors, c’est pour cela que j’ai employé un « nous » tout ce qu’il y a de plus collectif et dans lequel je m’inclus volontiers. Il est évident que le changement ne doit pas concerner la seule classe politique, mais bien toute la société, des citoyens aux médias. Cependant, ce billet reste tout de même le discours d’un militant politique.
Changeons… notre rapport à la réalité
On peut regretter avec autant de force que l’on voudra quelque chose, ce dernier n’en restera pas moins vrai. Ah si les gens s’intéressaient au fond des choses… Ah si les gens étaient cohérents… Ah si les gens étaient moins égoïstes… Ah si les gens étaient plus tolérants, intelligents, éduqués, de gauche, de droite, raisonnables, patients, objectifs… Ah si les gens votaient en plus grand nombre ! Bref si les gens (ou les citoyens, ou le peuple, enfin comme vous voudrez) étaient différents. Sauf qu’ils ne le sont pas ! Cela ne veut pas dire qu’il faut être résigné, mais aucun changement ne surviendra si on ne part pas de la réalité telle qu’elle est.
Communiquer est souvent vu comme un gros mot et opposé au débat intellectuel de fond, qui demande du temps et de la profondeur. Communiquer revient à privilégier la forme sur le fond. Cependant, dans un monde où l’on reçoit des centaines d’informations et de messages par jour, il est évident que la forme doit être soignée pour que le message ne se retrouve pas noyée et inaudible. Or peu de choses évoluent aussi vite que nos moyens et nos façons de communiquer. Le débat politique, public ou intellectuel doit évidemment s’adapter. Or le travail de réflexion et d’innovation en la matière reste très insuffisant. Pour beaucoup, la campagne « à la Obama » est le summum de la modernité, en oubliant qu’elle a eu lieu il y a bientôt 8 ans, soit une éternité.
Il est clair que le monde politique ne sait plus parler aux citoyens, promouvoir ses idées et mettre en valeur ses réalisations. Le citoyen perd alors tout intérêt pour la politique. On peut le regretter à l’infini, mais cela ne changera pas à coup d’injonctions et de discours culpabilisants ou en brandissant indéfiniment la peur du Front National. Il y a un travail constant d’adaptation à réaliser et aucune fatalité.
Ce rapport à la réalité ne se limite évidemment pas à la communication politique. Par exemple, le développement des nouvelles technologies a un fort impact sur notre organisation socio-économique. Il n’en est pas moins inéluctable. On peut toujours interdire un Uber, dix autres surgiront demain dans d’autres domaines. Il ne s’agit plus d’empêcher une mutation, même pas de la ralentir, mais de mesurer ses avantages et les problèmes qu’elle pose pour y répondre. Le déni représenterait évidemment la pire des situations. Là encore, il ne s’agit pas de subir, de se soumettre à une réalité, mais de la comprendre, de se l’approprier pour la faire évoluer dans une direction qui nous semble la bonne. Mais tant que l’on ne part pas d’elle, le combat est perdu d’avance.
Il est vrai cependant que tout cela est rendu difficile par la vitesse avec laquelle tout cela évolue.
Changeons… notre rapport au temps
« Le changement, c’est maintenant »… Le slogan de François Hollande est désormais un objet de raillerie. Il faisait en effet une promesse que l’action publique n’est guère en mesure de tenir, celle de l’immédiateté. La plupart des changements prennent du temps, du fait de la lenteur des procédures mais aussi (surtout ?) du temps de réaction de la société et de l’économie face à une impulsion donnée par la puissance publique. Qui peut imaginer que des sujets comme le chômage, les inégalités, l’environnement, l’urbanisme, les transports peuvent connaître un grand soir qui verrait la situation changer concrètement du jour au lendemain.
L’exemple du CICE est de ce point de vue là particulièrement éclatant. Annoncé par le Président de la République début 2013, il lui aura fallu une loi de finance et deux exercices fiscaux pour monter en régime et se concrétiser pleinement auprès des entreprises, soit près de 2 ans et demi. Et encore, il faut laisser du temps à ces dernières de l’intégrer et de le valoriser. Son impact réel n’est donc pas encore connu, alors qu’il apparaît déjà comme une mesure ancienne et que ses détracteurs ont déjà jugé inefficaces.
Le temps politique est très différent du temps médiatique et même désormais du temps économique. Un sujet ne va occuper la une des journaux que quelques jours et la mutation numérique impose une évolution rapide de pans importants de notre économie. Là est la réalité qu’il faut prendre en compte, qu’on la déplore ou non. Si le débat public ne s’adapte pas, il restera éloigné des citoyens et apportera toujours des solutions déjà obsolètes. A mon sens, cela impliquerait notamment l’abandon du bicamérisme pour éviter les allers et retours pendant des mois entre l’Assemblée et le Sénat. Chaque loi serait adoptée après un seul débat dans une Chambre unique, ce qui serait plus lisible pour le grand public et permettrait aux annonces de se concrétiser beaucoup plus rapidement.
Paradoxalement, un débat public mieux compris, plus clair, plus adapté à notre époque permettrait d’adopter plus facilement des solutions à long terme. Bien sûr, cela demandera aussi un effort de la part des citoyens qui devront comprendre que certaines difficultés se règlent dans la durée. Cela sera d’autant plus facile que les débats ne s’arrêteront pas à la simple adoption des lois.
Changeons… et donnons nous le droit à l’erreur
Notre pays souffre d’un manque cruel d’évaluation des politiques publiques. La Cour des Comptes remplit bien ce rôle, mais une optique avant tout financière. Pourtant, dans un monde qui évolue très vite, il semble d’autant plus vital de pouvoir ajuster la machinerie publique au fur et à mesure et de ne plus perdre de temps en allongeant la durée de vie de dispositifs qui ne fonctionnent pas. L’idée semble simple et de bon sens, pourtant elle est très délicate politiquement.
En effet, l’évaluation n’a de sens si on est capable de reconnaître ses erreurs. Et sans erreur, pas d’innovation. Or, avez-vous déjà vu un homme politique dire facilement qu’il s’est trompé ? Et s’il le fait, c’est avec moult périphrases pour faire croire que l’erreur n’en est pas une. En tant qu’élu local, je sais combien d’énergie j’ai du déployer pour faire admettre à la majorité municipale qu’elle n’avait rien fait en matière d’accessibilité et qu’elle mettait la ville dans l’illégalité la plus complète. C’était pourtant simplement vrai…
Mais voilà, on ne peut pas demander non plus au personnel politique d’accepter aisément de se suicider. Car la moindre erreur vous coûtera cher. Demandez donc à Myriam El-Kaoutari, ce qu’elle en pense ! C’est aussi au citoyen de changer et de voir dans un homme politique qui dirait « je me suis trompé » ou bien « je ne sais pas » un homme dans lequel on peut avoir justement confiance. Or c’est loin d’être le cas…
Changeons… le rôle de l’élu
Dans l’esprit de nombre de nos citoyens, la lumière vient toujours d’en haut. Le responsable politique doit trouver des solutions à tous les problèmes grâce à ces compétences. A défaut, il s’agit d’un escroc qui ne mérite ni son poste, ni son salaire et il se retrouve directement responsable de tous les maux de la Terre. Il doit être expert en tout et gare à lui s’il commet la moindre erreur ou s’il connaît le moindre échec.
Cette vision totalement verticale du fonctionnement de nos institutions et de la prise de décision politique est profondément dans notre culture nationale. En 2016, la France reste un pays profondément jacobin et quelque peu nostalgique de la monarchie. Et si cela se ressent dans le secteur public, nos grandes entreprises nationales baignent aussi largement dans cette culture. Mais voilà, la réalité, toujours elle, est que nous vivons dans un monde toujours plus horizontal.
L’élu doit donc cesser de se comporter comme le sachant qui détient la solution aux problèmes et le citoyen doit cesser d’attendre qu’il le soit. C’est un serpent qui se mord la queue et je ne sais pas très bien qui doit commencer. Mais il est urgent que cela change. La puissance publique doit prendre l’intelligence où elle est… c’est à dire partout ! Et pas simplement derrière les portes des cabinets ministériels. Cette évolution est pour moi certainement la plus essentielle et surtout la plus irrémédiable. Reste à savoir si la transition se fera ou non dans la douleur.
Mais tout espoir est loin d’être perdu. Nos élus n’étant pas les incompétents abrutis que certains voudraient, des initiatives dans ce sens ont déjà été prises. Des exemples de démocratie participative dans les collectivités avec l’amorce de budget participatif de la ville de Paris. Mais aussi des exemples d’interactions fortes entre les acteurs publics et une expertise extérieure, y compris au niveau de l’Etat. La loi sur le numérique présentée le mois dernier par Axelle Lemaire a fait l’objet d’une grande consultation sur Internet qui a fait évoluer de manière significative le projet de loi. Dans la même idée, l’expérimentation des territoires zéro chômage de longue durée, qui a fait l’objet d’un vote unanime à l’Assemblée Nationale, est le fruit de l’appropriation par la puissance publique d’un dispositif imaginé par un acteur associatif, à savoir ATD Quart-Monde.
Il est vraiment regrettable que ces initiatives n’aient pas fait l’objet d’une plus forte médiatisation. Cela reste peut-être timide, mais cela représente pour moi l’avenir de l’action politique. L’élu doit passer du rôle d’inventeur de solutions à celui qui saura les faire émerger d’une réflexion qui aura impliqué une base beaucoup plus large. Il occuperait alors réellement son rôle d’arbitre qui devrait être déjà avant tout autre le sien. Ce changement assez fondamental ne devra cependant pas concerner que les élus. Les corps intermédiaires, partis politiques, syndicats, associations représentatives, devront aussi s’adapter. Le passage d’une structure pyramidale et une structure beaucoup plus horizontale ne peut se faire que par la pointe, mais doit bien concerner toute la structure préexistante.
Il doit donc aussi concerner les citoyens. Tous les élus locaux savent bien que la concertation se heurte souvent à une immense indifférence de la part de ceux même qui n’arrêtent pas de prétendre qu’on ne les écoute pas. Mais il est vrai aussi, que la concertation est souvent assez improvisée et se limite à un simple cahier de doléances mis à disposition. Or, il existe bien des techniques et des outils bien plus efficaces pour la mener. Le développement des outils numériques doivent les rendre plus accessibles et aider à leur diffusion.
Mais il est aussi capital que le débat se fasse sur des bases saines.
Changeons… et sortons du manichéisme
Oui ou non, pour ou contre, droite ou gauche, gentil ou méchant… Le débat politique se limite souvent à une discussion totalement binaire où tout est blanc ou noir. Tous les acteurs savent que ce n’est pas vrai, mais pour avoir un impact médiatique fort, il est important de surjouer tous les désaccords. Les réseaux sociaux n’ont d’ailleurs rien arrangé en la matière. Ceci pourrit totalement la qualité du débat, qui s’apparente de plus en plus à un échange d’invectives.
Mon fameux principe de réalité me fait dire que sortir de cet état de fait se révélera particulièrement compliqué. Si vous adoptez une position moins tranchée et que cela vous fait immédiatement disparaître des médias, vous ne serez pas du tout incité à vous comporter de la sorte. Alors peut-être que c’est avant tout à ces derniers de donner l’exemple. Et une des manières les plus simples de le faire est de modifier la manière dont les questions sont posées dans les sondages.
Si on avait transformé le référendum sur la Constitution Européenne en une question du type : vous souhaitez 1-que le texte soit adopté, 2-que le texte soit revu, 3-que l’on reste à la situation actuelle, 4-que l’on ne soumette à aucun texte et que l’on sorte de l’Union Européenne, il est évident que c’est très certainement la première option qui l’aurait emporté. En évitant d’agglomérer des oppositions reposant sur des motivations totalement différentes, on aurait réalisé une véritable consultation citoyenne reflétant beaucoup plus clairement le sentiment de chacun.
Mon exemple n’est pas peut-être pas parfait car un référendum doit aboutir à une prise de décision et une majorité y est sans doute nécessaire. Par contre, si les sondages s’inspiraient de ce modèle, cela irriguerait de manière beaucoup plus vertueuse le débat politique. Cela empêcherait déjà certains de s’approprier un camp du non qui recouvre le plus souvent des opinions très différentes des siennes. Et cela forcerait tout le monde, y compris le citoyens, à se positionner systématiquement pour quelque chose et non contre. Certes, cela peut-être pour quelque chose en réaction à quelque chose d’autre, mais c’est le « pour » qui compte.
Et au premier rang des sujets que cela doit concerner, la lutte contre le Front National…
Changeons… notre manière de lutter contre le Front National
De mon point de vue, le problème est assez simple. La meilleure façon de lutter contre le Front National est encore de ne JAMAIS en parler. On le laisse communiquer, on ne le censure pas, il a le droit d’exister, mais on ne lui fait jamais de publicité en l’évoquant ou en lui répondant. Je suis profondément convaincu qu’il n’existe pas de mauvais publicité. Parler de quelque chose, c’est déjà le faire connaître et l’aider à diffuser ses idées.
Personnellement, j’ai mené une campagne municipale sans mentionner nulle part sur aucun de mes documents la majorité municipale sortante. Certes, dans le cours de mon mandat, en tant que leader de l’opposition, je suis amené à commenter les décisions prises par mon Maire et son équipe. Mais la campagne électorale est pour moi le moment de la confrontation des projets et ce n’est pas à moi de distribuer les bons ou les mauvais points, mais aux électeurs. Et je suis persuadé que cette attitude ne m’a coûté aucune voix. Bon, pas évident qu’elle m’en ai rapporté beaucoup, mais je sais qu’elle m’a fait gagner le respect de beaucoup d’acteurs de la commune qui me témoigne une confiance que je n’aurais pas gagné autrement.
Plus largement, comment voudrait-on que les citoyens ne pensent pas que tous les hommes politiques dont des crétins incompétents… quand ils ne cessent entendre des hommes politiques parler dans le médias pour dire, à propos d’une autre personnalité politique, qu’elle est un crétin incompétent ? Arrêter de parler des autres, mais à la place parler uniquement de soi et de ce qu’on propose peut paraître un principe angéliste et particulièrement utopiste, mais je crois qu’il est peut-être le préalable à tout le reste.
Comme je l’ai moi-même exposé, ce n’est pas parce que j’aurais écrit ça au bout d’un texte de 4 pages que peu de gens liront, que la réalité changera. Le problème est bien qu’à chaque scrutin la réalité des problèmes rattrape un peu plus non pas simplement le microcosme politique, mais toute la société. Et le choc pour être un jour brutal et catastrophique. Je reste encore assez optimiste pour penser qu’il pourra être éviter. Mais pour cela il faudra changer…
… Alors changeons !

 On a beaucoup parlé démocratie ces dernières semaines et encore plus ces derniers jours, entre Nuit Debout et le 49-3. Comme tous les sujets qui font la une des réseaux sociaux, cela a donné lieu à son lot d’outrages, d’approximations et de mauvaise foi, à côté évidemment aussi de réflexions de fonds et beaucoup de traits d’humour savoureux. Cependant, il apparaît clairement que la démocratie fait partie de ces notions qui semblent assez simples pour être une valeur absolue manichéenne. Une décision, un processus est démocratique ou pas, noir ou blanc, sans gris… Et pourtant…
On a beaucoup parlé démocratie ces dernières semaines et encore plus ces derniers jours, entre Nuit Debout et le 49-3. Comme tous les sujets qui font la une des réseaux sociaux, cela a donné lieu à son lot d’outrages, d’approximations et de mauvaise foi, à côté évidemment aussi de réflexions de fonds et beaucoup de traits d’humour savoureux. Cependant, il apparaît clairement que la démocratie fait partie de ces notions qui semblent assez simples pour être une valeur absolue manichéenne. Une décision, un processus est démocratique ou pas, noir ou blanc, sans gris… Et pourtant…






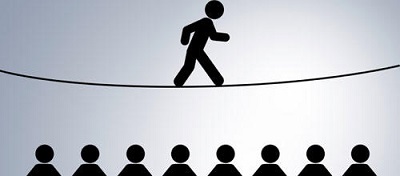

Commentaires récents